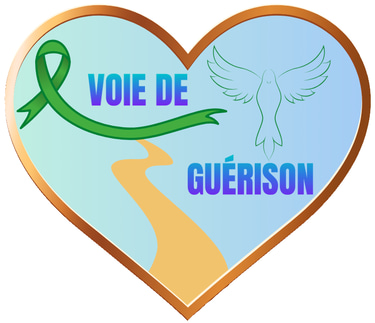Qu'y avait-il encore à faire pour mon enfant, que je n'aie pas fait pour lui?
Quelques conseils pour aider les parents dans le grand défi des comportements liés à la recherche d’identité de leur adolescent.
Ralph Séraphin
8/17/20255 min read


Toutefois, arrivé à l’adolescence, la réalité peut prendre une tournure différente. Les mêmes enfants, autrefois réceptifs et dociles, commencent parfois à faire des choix qui s’éloignent des attentes parentales. Il ne s’agit pas de changements liés uniquement à l’apparence physique, mais bien de décisions et de comportements qui semblent contraster avec l’éducation reçue, et parfois même entrer en contradiction avec les valeurs familiales. Cette période de transition peut être source d’incompréhension et de désarroi pour les parents, qui se questionnent alors : « Qu’aurais-je pu faire de plus pour mon enfant ? »
Si, en tant que parent, vous n'avez jamais vécu une telle expérience conflictuelle avec vos adolescents ou jeunes adultes, il est juste de reconnaître que vous faites partie d'une minorité privilégiée. Une telle situation est non seulement exceptionnelle, mais aussi une grâce particulière accordée par Dieu.
Qu'est-ce que j’ai fait de mal?
Cette question revient fréquemment chez les parents confrontés aux comportements déviants de leur adolescent ou de leur jeune adulte. Elle traduit un sentiment de culpabilité qui, s’il n’est pas reconnu et travaillé, peut mener à une détresse émotionnelle, voire à un état dépressif. En se concentrant sur un passé qu’ils ne peuvent modifier, certains parents développent une tendance à l’auto-accusation, interprétant les choix ou les difficultés de leur enfant comme le reflet direct de leurs propres erreurs.
Pourtant, les comportements des jeunes doivent être compris dans une perspective développementale plus large. Selon Erik Erikson, l’adolescence correspond à la crise identitaire « identité vs confusion des rôles ».
Ce que vous devez comprendre, c’est que l’adolescence n’est pas l’étape finale du processus de vieillissement. Si la puberté peut commencer précocement, dès l’âge de 10 à 12 ans, le cerveau, lui, n’atteint sa pleine maturité qu’aux alentours de 25 ans. De plus, le lobe frontal, siège du raisonnement et du discernement, est le dernier à se développer. Ainsi, lorsque vos adolescents ou jeunes adultes semblent parfois “perdre le contrôle”, ce n’est pas forcément le reflet de vos erreurs, mais bien une étape normale de leur maturation neurologique et psychologique.
Pour être honnête, si tu prends quelques minutes pour réfléchir sur ta vie, quand as-tu pris la décision de suivre le Seigneur? Je ne te demande pas à quel âge tu as été baptisé, mais le jour où tu as décidé de vraiment marcher dans la voie que tu as appris dès l’enfance? Pour certains, cette décision a peut-être été spontanée, tandis que pour d'autres, il s’agit d’une transition progressive.
À retenir
Être parent ne signifie pas tout contrôler. Malgré tous vos efforts, vos enfants feront leurs propres choix, surtout à l’adolescence. Comme nous, ils sont dotés du libre arbitre. Le fait qu’ils prennent des décisions contraires à nos instructions ne reflète pas un échec de notre part, mais fait partie de leur chemin de maturation et de construction identitaire. Se culpabiliser ne change rien : comprendre le développement psychologique et accepter l’influence des pairs permet de retrouver sérénité et confiance.
Cependant, votre rôle reste essentiel. Il faut continuer à marcher à leurs côtés avec amour, patience et foi, en leur offrant un exemple vivant et en les laissant progresser vers leur propre rencontre avec Dieu.


Même dans le cadre d’un attachement sécurisant, certains événements de la vie comme un divorce, un déménagement, l’absence d’un parent ou une migration peuvent représenter des facteurs de stress majeurs pour la famille. Bien que ces transitions puissent être vécues comme des occasions de développer une résilience accrue, elles sont très souvent perçues comme des perturbations génératrices d’anxiété et de comportements problématiques.
Il est essentiel de rappeler que ces événements échappent souvent au contrôle des parents. Dans la majorité des cas, les décisions prises le sont avec l’intention sincère d’améliorer la qualité de vie de la famille. Du point de vue psychologique, ce n’est donc pas tant l’événement en soi qui détermine l’impact sur l’enfant, mais la manière dont il est accompagné, expliqué et intégré dans son parcours de développement.
C’est une période marquée par la recherche d’autonomie, l’expérimentation et parfois la confrontation avec les figures d’autorité, notamment les parents. Les comportements déstabilisants ne sont donc pas nécessairement le signe d’un échec éducatif, mais souvent l’expression d’un processus normal d’individuation.
Arrêtez de vous culpabiliser
Les recherches montrent qu’à l’adolescence, l’influence des parents sur les choix de leur enfant diminue considérablement. Ce sont désormais les pairs qui occupent une place centrale. Le besoin d’appartenance au groupe d’amis devient souvent plus fort que le lien avec la famille, surtout lorsque ces influences entrent en contradiction avec les valeurs transmises à la maison.
L’adolescence est avant tout une étape de construction identitaire. Le jeune cherche à se découvrir, à comprendre qui il est et quelle est sa place dans la société. Cette quête s’accompagne de la puberté, période de profonds changements physiques, psychiques et affectifs. Elle ouvre la porte aux premiers sentiments amoureux et aux questionnements liés à l’attirance sexuelle. Mais l’un des plus grands défis de cette étape réside dans la remise en question des valeurs et des croyances que les parents ont patiemment inculquées depuis l’enfance. N’est-ce pas pourtant l’Écriture qui nous rappelle : « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas » (Proverbes 22.6) ?


La naissance d’un nouveau-né vient toujours avec ses joies, mais également accompagné de responsabilités et de défis. Dans la majorité des cas, des parents attentifs et soucieux du bien-être de leur nouveau-né s’efforcent de répondre à ses besoins essentiels. Ils veillent à lui assurer une alimentation adéquate pour soutenir sa croissance, à le vêtir convenablement selon les saisons et à lui offrir un environnement sécurisant. Puis, au fil des ans, ils cherchent à lui transmettre un héritage plus précieux encore : l’éducation, les valeurs morales et la foi, piliers d’une vie droite et épanouie.
Ralph Séraphin B.S.S, M.S.S., T.S.I.
Thérapeute en santé mentale auprès des jeunes du primaire et du secondaire.